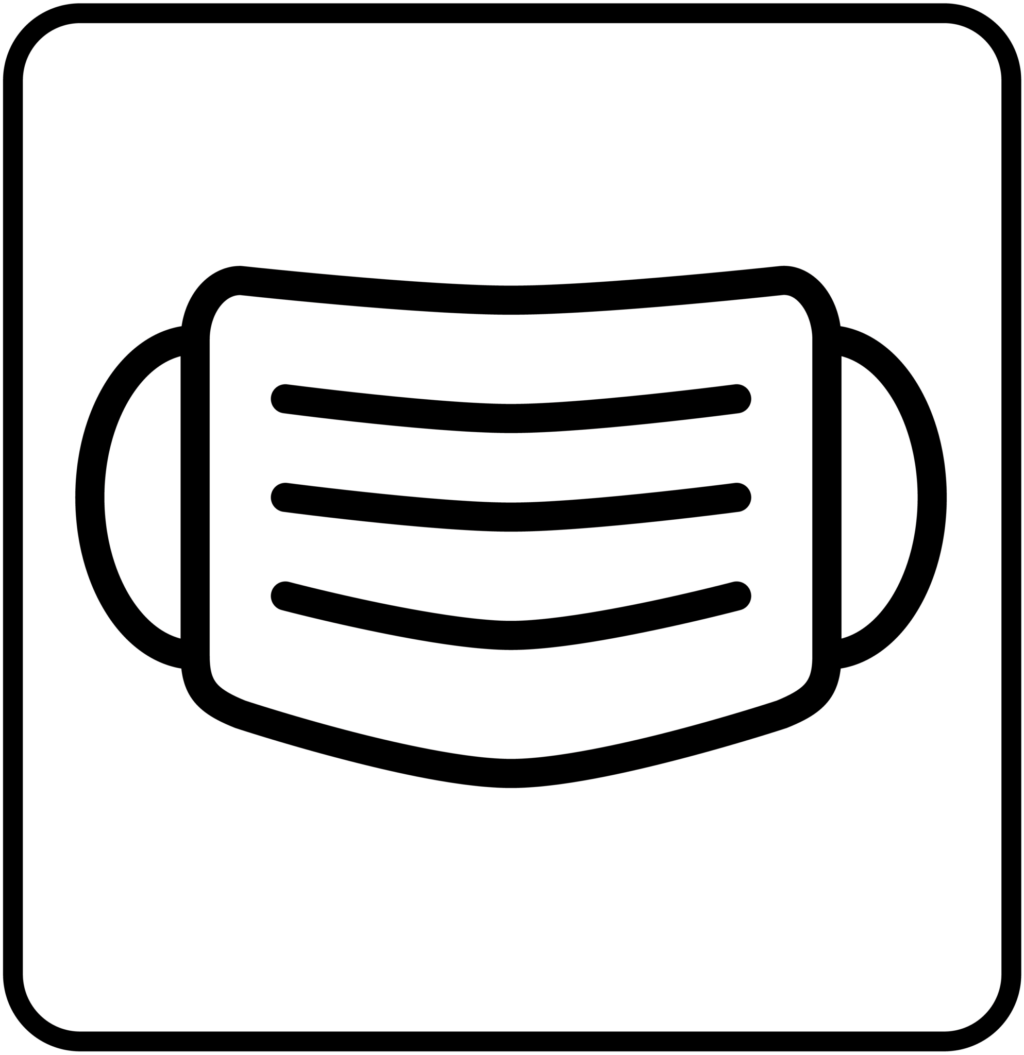Cet article fait partie d’une série d’autographies réalisées par la sociologue Marine Kneubühler. Elle y restitue à la première personne son expérience relative au port du masque, éclairant ainsi diverses situations et mesures sanitaires auxquelles la pandémie a donné lieu. Le premier article de la série est disponible ici.
Le lundi 28 septembre 2020, j’ai repris le boulot après deux semaines de vacances marquées par une inattention à l’égard du port du masque. En ouvrant ma boîte mails, j’ai été immédiatement replongée dans le bain de la pandémie. De nombreux messages donnaient des informations sur « une rentrée universitaire pas comme les autres ». La Direction de l’Université a notamment organisé une distribution de masques en tissu que les étudiantes et étudiants ont été invités à récupérer à différents endroits sur le campus. Le 24 septembre, j’ai reçu un e-mail de la secrétaire de laboratoire intitulé « Masques en tissu disponibles » :
| Chères et chers collègues, |
| Je vous informe que les masques sont disponibles dès aujourd’hui. Vous pouvez venir chercher vos deux masques au secrétariat. |
| Vous trouverez ci-joint le mode d’emploi qui nous a été remis par Unisep. |
En tant qu’employée, j’ai donc droit à deux masques en tissu. Je suis très curieuse et impatiente de les découvrir, n’ayant jamais porté d’autres sortes de masque que les masques chirurgicaux. Je prévois d’aller les chercher le lendemain ; j’ai des rendez-vous à Lausanne, dont un professionnel le matin sur le campus, et de multiples petites affaires à gérer par-ci par-là. J’ai répondu à la secrétaire pour l’informer de ma venue au bureau – car il est toujours nécessaire de « tracer les contacts » – et lui ai précisé que j’en profiterai pour récupérer mes masques au secrétariat.
Mardi 29 septembre 2020, je me sens reposée mais j’aurais aimé avoir davantage de jours de repos. Je ne puise plus dans mes réserves mais mon énergie est encore relativement basse. Je ressens aussi de la frustration : en plus de devoir me réinstaller dans une routine, je dois tenir compte de nouvelles contraintes sanitaires sur mon lieu de travail. Sans compter que je me trouve encore dans une phase adaptative avec l’arrivée de mes colocataires dans l’appartement ; mes chats, eux, se sont plutôt bien accommodés à la nouvelle dynamique. Je marche en direction de la gare et me compare à mes chats. J’estime qu’ils se sont habitués plus rapidement à la présence d’un chien sur leur territoire que moi au port du masque ; c’est un poil décourageant. Ce matin, j’ai contrôlé qu’il restait suffisamment de masques dans l’enveloppe laissée dans mon sac à dos ; mais je n’ai pas eu le courage d’en mettre un à la maison. Cependant, j’ai pensé à m’attacher les cheveux ! Détachés, mes cheveux génèrent des désagréments et inconforts non négligeables avec le port du masque.
Arrivée sur le quai, je me dirige vers une machine pour acheter un billet. J’effectue l’opération machinalement en pensant que je n’ai pas envie de reprendre mes notes autographiques tout de suite. J’aimerais mieux rester dans une forme d’inattention qui a été plutôt agréable à vivre pendant les vacances. En même temps, j’évite de trop y penser car, avec le recul, je commence à ressentir des pics de rejet vis-à-vis de ma pratique du masque à cette période ; en fait, je la trouve absurde : tous ces masques portés à la va-vite, parfois moins de cinq minutes sans croiser personne dans le magasin, quel gaspillage… Je ressens une immense angoisse sur les dégâts que ces masques pourraient ajouter à l’environnement. Mon billet acheté, je me dirige vers un banc en pierre pour enfiler un masque. En m’asseyant, je me demande comment vont être les masques en tissu de l’Université de Lausanne (Unil) ; j’espère qu’ils sont pratiques et jolis. Je trouve que c’est une bonne initiative pour l’environnement. Je peine à m’imaginer concrètement un masque en tissu pratique et joli.
J’ouvre mon sac et y prends la petite bouteille de solution hydro-alcoolique ; j’en mets une bonne giclée dans une paume de la main, referme la bouteille et la range dans mon sac. J’étale le gel en frottant mes mains l’une contre l’autre. À cet instant précis, je me rappelle ne pas avoir été très assidue sur le lavage des mains avant de mettre un masque pendant les vacances ; je ressens un peu de culpabilité mais je me dis aussi que le monde ne s’est pas écroulé à cause de ce petit écart. Je plonge ensuite ma main dans mon sac en visant avec précaution l’élastique d’un masque se trouvant dans l’enveloppe restée entre-ouverte.
Très concentrée pour ne pas toucher les bords du sac, je sors un masque par l’élastique du bout des doigts ; je laisse mon sac sur le banc à mes côtés. Je tire délicatement sur le haut et le bas du masque puis, un élastique enroulé entre les doigts de chaque main, j’applique le masque contre mon visage et effectue une boucle croisée autour des oreilles avec les élastiques pour les raccourcir. Du bout des doigts de la main gauche, j’appuie sur la barre se trouvant au-dessus du nez et tire le bas du masque de la main droite pour qu’il recouvre bien mon menton. J’ajuste enfin mes lunettes au-dessus du masque depuis les branches.
Le train arrive en gare alors que je referme mon sac. Il est 8h45, il n’y a quasiment personne sur le quai. Je me lève en plaçant les lanières de mon sac sur le dos et accélère le pas, voyant les wagons de deuxième classe filer à l’opposé de ma position sur le quai. Le train s’arrête, je me trouve au niveau du wagon restaurant. Je fais quelques pas de course, appuie sur le bouton pour ouvrir la porte et monte rapidement dans le wagon. Un peu de buée est venue se loger sur le coin d’un verre de mes lunettes ; elle disparaît rapidement. Le train est quasiment vide. Je trouve facilement une place libre avec de l’espace autour de moi. Je m’installe. J’essaie de prendre quelques notes sur mon téléphone. Je sens une résistance qui me fait comprendre que j’ai besoin d’y aller doucement. Je m’écoute. Je ferme l’application Notes et vais chercher dans mon sac mes écouteurs que je branche à mon téléphone. Je lance une playlist musicale sur YouTube. Je regarde dehors. Je laisse les pensées me traverser ; je ne les arrête pas. Je sens mon masque contre mon visage de la même façon que je sens des chaussures à mes pieds ou des bagues autour de mes doigts.
Le train arrive en gare. Je descends et me dirige vers le métro, toujours en écoutant de la musique ; sous mon masque, je chantonne. En traversant le passage sous-terrain, mon attention est soudainement attirée par des affiches colorées « À vous d’agir » ; je reconnais la banderole jaune des affiches de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans le coin en haut à gauche mais ce n’est pas une affiche de campagne standard contre le coronavirus. Je m’approche un peu ; ils ont dû lancer une nouvelle stratégie de communication à destination des jeunes, me dis-je, en l’occurrence celles et ceux qui côtoient les boîtes de nuit :

Je ne comprends pas très bien parce qu’il me semble que les boîtes de nuit ont justement été fermées ; mais qu’est-ce que le mot « boîte » pourrait bien vouloir dire d’autre dans ce contexte ? Je continue ma route jusqu’au métro et commande, en marchant, un billet depuis mon téléphone. Je suis les marques de direction au sol machinalement. Le métro se trouve déjà sur le quai : je saute dedans. La musique à fond dans les oreilles, je descends au premier arrêt et me rends d’un bon pas vers la station de mon prochain métro. Je sautille presque en suivant le rythme énergique d’une chanson. Je sens la présence des autres autour de moi mais je ne les regarde pas ; j’avance. Ces nouvelles affiches m’ont rendue curieuse ; en montant dans la rame de métro, presque vide, je m’assieds et lance tout de suite une petite recherche Internet à propos des campagnes de l’OFSP.
Dans un article, le site de la Confédération annonce en effet une « nouvelle phase » de campagne « pour endiguer le nouveau coronavirus » ; « L’ensemble de la population est concerné » mais, comme je l’avais repéré, l’Office fédéral « s’adresse spécifiquement aux jeunes » avec ces affiches-là. L’article propose un lien de téléchargement qui renvoie au site de l’OFSP. Cela me prend un peu de temps pour trouver la page dédiée spécifiquement à cette campagne mais j’y parviens. Cinq affiches différentes ont été confectionnées ; je les regarde en détail. Je constate que c’est une traduction en mode « dessin animé » de certaines consignes sanitaires qui sont associées à des activités et un langage « jeunes » : traçage (« Le summum du savoir-vivre : laisser un pourboire et ses coordonnées » et « Le point commun entre ton crush et ta boîte préférée ? Les deux veulent ton numéro »), dépistage (« Des symptômes ? Enchaîner les séries TV et faire un dépistage du coronavirus »), distanciation (« Ni main ni poing ni gros câlin : on se salue toujours à distance ») et respect des quarantaines (« Seuls pour le bien de tous : respecter l’isolement et la quarantaine »).
Je me demande si ce genre de campagne est vraiment efficace. Le métro s’arrête à la station de l’Université : je descends et me dirige vers l’entrée principale du bâtiment en pensant à cette nouvelle campagne. Je n’ai pas sauvegardé les pages Internet de mes recherches ; j’espère les retrouver facilement depuis mon historique Internet. Dans le sas d’entrée, j’enlève mes écouteurs et ferme les applications ouvertes sur mon téléphone. À travers les vitres donnant sur l’intérieur du bâtiment, j’aperçois quelqu’un vers la station de désinfection sur pied placée au milieu du chemin. On dirait un agent de sécurité. J’avance, les portes automatiques s’ouvrent : c’est bien un agent de sécurité ; il porte un uniforme noir. Il regarde ailleurs, les mains dans le dos, l’air décontracté. Dès qu’il m’aperçoit, il se redresse, se tourne vers moi et me lance sur un ton ferme : « Campuscard s’il vous plaît ! » Je pouffe de rire ; je ne m’attendais vraiment pas à un contrôle.
J’ouvre la pochette de mon porte-monnaie où se trouve ma carte en lui disant : « Bonjour, pardon, j’ai rigolé, vous m’avez surprise, ça fait un moment que je ne suis pas venue au bureau ». Je lui tends ma carte et il me dit : « vos mains, s’il vous plaît ». « Quoi ? » Il me montre un spray qu’il tient avec des gants ; nous nous trouvons devant une station de désinfection automatique, je ne comprends pas, je me sens embarrassée et désorientée. Je range ma carte et fais glisser le cordon de la pochette de mon téléphone autour de mon poignet. Incertaine, je tends ensuite mes mains à l’agent, l’une contre l’autre, comme si elles formaient un petit panier. Il appuie deux fois sur son spray ; mes mains sont dégoulinantes et ça sent la gnole. Je frotte mes mains, encore perplexe et écœurée par l’odeur ; à croire que ce gel-là est seulement alcoolique. Je dis à l’agent, penaude : « C’est bon, j’ai le droit d’aller travailler ? » ; il répond « oui, oui, bonne journée ». Je ne lui réponds pas ; je pars, je ne ris plus du tout, je reste bloquée sur l’incongruité de sa présence.
Je me dirige vers le boîtier de validation des Campuscards, une action qui permet aux employés d’ouvrir leur bureau. En validant ma carte, je ne reviens toujours pas de cette interaction ; on aurait dit que j’essayais d’entrer en boîte de nuit. Je prends les escaliers et, au premier étage, je croise une immense affiche bleue et blanche, couleurs du logo de l’Unil, qui présente les « règles sanitaires sur le campus ». Un grand carré blanc met en évidence le dessin minimaliste d’un masque. Je prends l’affiche en photo :

Je continue de monter les marches d’escalier ; je croise plusieurs personnes, toutes masquées. De loin, j’aperçois un collègue avec un masque blanc étrange plaqué contre son visage. Je parviens au dernier étage, légèrement essoufflée ; mon masque me tient chaud. Je passe aux toilettes ; je suis contente de me laver les mains avant de sortir pour ôter cette affreuse odeur de désinfectant. Dans le miroir, je me dis que mon masque est bien mis et ça me fait plaisir de ne pas avoir à m’en préoccuper.
En traversant les couloirs pour me rendre à mon bureau, je passe devant un couple qui se bécote sur un canapé ; ce n’est absolument pas corona-compatible mais leur insolence me fait sourire. Je trouve cette scène vraiment drôle : tous les canapés ont été restreints dans leur capacité par une quantité invraisemblable de cellophane, pour forcer à la séparation et la distanciation et, là, au milieu des couches de cellophane, deux personnes l’une sur l’autre. Je m’amuse du contraste entre l’agent de sécurité chargé de faire la police sanitaire en bas du bâtiment et, tout en haut, sur leur perchoir, les tourtereaux qui mélangent leurs microbes.
À deux pas de mon bureau, je me dis que c’est en fait totalement incongru de choisir les couloirs d’une institution académique pour se bécoter un mardi matin. J’entre dans mon bureau en me questionnant sur la vie de ces tourtereaux et je pense aux discothèques qui ont fermées et aux lieux de convivialité masqués. Je dépose ma veste et mes affaires, ne gardant que mon téléphone en main et ressors immédiatement pour me rendre au bureau de ma collègue Léa[1], avec qui j’ai rendez-vous. Je pousse la porte de son bureau qu’elle a laissée entre-ouverte. Je la salue. Elle a déposé son masque chirurgical à côté de son ordinateur. Dès qu’elle me voit, elle sourit, me salue en retour puis attrape son masque ; elle l’enfile en deux temps trois mouvements.
Nous papotons quelques minutes puis décidons de nous rendre à la cafétéria pour s’entretenir avec une autre collègue, Noémie. Je propose à Léa de prendre les escaliers, elle accepte. En descendant, je lui raconte mon interaction avec l’agent de sécurité et aussi la scène des tourtereaux. Nous entrons dans l’espace de la cafétéria, je suis complètement immergée dans nos échanges, je la suis et prête très peu d’attention à l’environnement. Nous apercevons Noémie au loin, déjà attablée avec un café ; nous lui faisons signe et nous dirigeons vers le comptoir dédié aux commandes des cafés. Nous continuons de parler en nous plaçant côte à côte dans une courte file d’attente et en respectant une certaine distance avec la personne en face de nous. Notre tour vient ; j’en profite pour acheter un sandwich à l’emporter pour mon repas de midi.
Un petit plateau dans les mains, je suis Léa entre les tables pour rejoindre Noémie. Je commence à me demander ce qu’on va faire de nos masques ; cette situation me génère du stress. Je n’ai pas d’autre masque avec moi, ni de pochette pour ranger celui que je porte. C’est la première fois que je vais devoir enlever un masque pour consommer une boisson puis le remettre. Je ne suis pas à l’aise avec cette situation d’entre-deux, je la redoutais même ; je la considère comme un écart au regard des consignes officielles du port du masque. Clairement, je n’ai pas envie de l’enlever et de le remettre.
On s’assied, je ne vois aucun masque visible autour de Noémie ; je pose le petit plateau sur la table tandis qu’on échange des salutations ; je vois Léa enlever son masque et l’enrouler autour de son avant-bras par les élastiques. Sans réfléchir, je m’assieds et l’imite. Je retire mon masque en saisissant les élastiques par le dessous des oreilles entre mes doigts ; je défais les boucles en soulevant les élastiques et tire le masque vers l’avant. Je fais glisser les deux élastiques autour de mon poignet gauche et effectue une boucle avec les doigts de la main droite pour que le masque ne glisse pas. Je fais bouger mon poignet en contemplant le résultat. Je trouve que c’est une bonne idée de faire ainsi le temps d’un café, c’est pratique, dis-je à Léa en inclinant mon poignet vers elle. Elle me répond que, en effet, cela lui semble être une bonne solution. Elle a l’air d’y avoir pensé ; je sens bien qu’elle s’est déjà trouvée à plusieurs reprises dans cette situation. Son expertise et la solution qu’elle m’a permis d’adopter très vite m’ont apaisée.
Notre réunion de travail conviviale se termine. Léa et Noémie se lèvent puis remettent leurs masques debout tandis que moi, tout en restant assise, je tire, sans trop forcer, sur les élastiques du mien, afin de les dénouer et les retirer de mon poignet. Cette action me fait penser à l’histoire de mon amie Myriam, quand les élastiques de son masque avaient soudainement craqué à la caisse d’une station-service ; j’espère que porter ainsi mon masque en bracelet ne l’a pas fragilisé. Un élastique entre les doigts de chaque main, je vois que le masque a gardé la forme de mon visage ; je n’ai qu’à l’appliquer à nouveau en effectuant des boucles autour des oreilles avec les élastiques et le tour est joué. Il a l’air d’être solide et je vais bientôt m’en débarrasser ; mon inquiétude s’en va alors que je me lève en ramassant mon plateau. Noémie et Léa discutent un peu plus loin entre deux rangées de table, je les rejoins et nous nous dirigeons ensemble vers la sortie.
En déposant mon plateau sur le tapis roulant menant aux cuisines, je me rends compte qu’il y a tout un tas de nouveaux panneaux, dispositifs matériels et marques au sol à l’entrée de la cafétéria auxquels je n’avais pas prêté attention en arrivant. Prise dans l’interaction avec mes collègues, je n’arrive pas à examiner ces dispositifs en détail. Je constate simplement que des flèches imposent maintenant un sens de marche avec une entrée et une sortie bien distinctes là où, avant, l’on pouvait circuler librement. Nous suivons les flèches et nous arrêtons un instant en bas des escaliers en face de l’entrée du bâtiment ; je constate qu’il n’y a plus d’agent de sécurité pour contrôler les allées-venues ; l’écart de traitement entre personnes, certaines pouvant entrer tranquillement et d’autres se trouvant coincées par des contrôles zélés, me met en colère. J’aurais aimé moi aussi échapper à cette contrainte mais j’essaie de ne pas en tenir compte en restant à l’écoute de mes collègues. Noémie doit se rendre dans un autre bâtiment du campus ; elle nous quitte. Nous la saluons et allons prendre l’ascenseur avec Léa pour remonter à nos bureaux. J’appuie sur le bouton pour appeler l’ascenseur. Tout en me parlant, Léa se désinfecte les mains avec un distributeur de désinfectant automatique sur pied posté devant les ascenseurs ; je l’imite.
Devant nos bureaux, nous récapitulons les éléments organisationnels que nous avons fixés durant la réunion puis allons travailler chacune de notre côté. De retour à mon bureau, je commence à ressentir le besoin de changer de masque mais je ne l’enlève pas tout de suite ; j’aimerais d’abord aller chercher mes masques en tissu au secrétariat. Avant de ressortir, j’allume mon ordinateur et m’assieds dans l’intention de vérifier l’e-mail de la secrétaire de laboratoire qui contient le mode d’emploi des fameux masques. Après quelques manipulations informatiques, je retrouve l’e-mail en question et ouvre le document en fichier attaché pour l’imprimer et l’enregistrer dans mes dossiers. Je double-clique : un document de deux pages s’ouvre. Deux pages ! Mais what ? Je scrolle avec ma souris : c’est bien cela, deux pages de texte. Ohlala. J’hallucine mais c’est quoi comme masque ? Je remonte jusqu’au titre : « Masque de protection en tissu. Notice d’utilisation. Avertissement. Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d’utilisation ». Mais ! On dirait l’introduction du mode d’emploi d’un outil dangereux. Bon. Je lance l’impression, un peu inquiète.
Je sors de mon bureau pour récupérer le mode d’emploi à l’imprimante qui se trouve pile en face. Il y a un spray désinfectant sur l’imprimante mais je ne l’utilise pas. Je retourne rapidement dans mon bureau avec mes deux fiches imprimées ; j’observe les quatre images sur la première page. Je ne me retrouve pas dans les gestes représentés. Je fronce les sourcils en regardant de plus près le premier dessin ; on dirait qu’il faut se laver les mains avec le masque. Au secours ! Est-ce que la personne qui a réalisé ces dessins a déjà mis un masque dans sa vie ?

Je dépose les feuilles sur mon bureau puis ressors directement pour me rendre au secrétariat. Je croise quelques personnes dans les couloirs et, en l’occurrence, toutes portent un masque chirurgical. En fait, je pense n’avoir vu aucun masque Unil porté depuis mon entrée dans le bâtiment. J’arrive à destination ; la porte du bureau est entre-ouverte. Je toque malgré tout pour annoncer ma présence et pénètre discrètement dans la pièce. C’est un bureau collectif ; l’une des secrétaires est présente mais pas celle qui distribue les masques :
| Secrétaire : | Hello ! |
| MK : | Coucou, je suis venue chercher les masques auprès de Marie, je l’ai ratée ? |
| Secrétaire : | Non non, elle est juste allée aux toilettes, elle arrive. |
| MK : | Ah ok, super merci ! Marie entre à ce moment-là dans le bureau, elle m’identifie tout de suite. |
| Marie : | Salut, tu viens chercher les masques ? |
| MK : | Hello, oui exactement ! Mes yeux se posent sur des boîtes en carton posées sur le sol, remplies de tissu blanc. |
| Marie : | Attends juste une seconde, j’arrive, faut que je note. |
| MK : | Pas de souci, prends ton temps. |
Marie s’affaire derrière son bureau pendant que j’essaie d’examiner plus précisément le contenu des boîtes en carton. Je tente d’identifier si ce sont les masques mais ça ressemble plutôt à des chaussettes ou des petites couches culottes. Non mais pitié, j’espère que ce ne sont pas les masques. Je regarde tour à tour Marie et sa collègue ; elles portent des masques chirurgicaux. Mais qu’est-ce qu’ils ont inventé comme masque ? Marie se dirige vers les cartons. Elle en sort deux masques qu’elle me tend par les élastiques. Vraiment, on dirait deux petites couches culottes blanches. Je les récupère par l’élastique en faisant attention que nos mains ne se touchent pas ; je réfrène de toutes mes forces l’envie de dire à voix haute que je vois des couches.
| MK : | Merci beaucoup. |
| Marie : | De rien. J’ai noté, c’est tout bon. |
| MK : | D’accord. |
| Marie : | Désolée, j’ai beaucoup à faire, faut que j’y retourne. |
| MK : | Oui, bien sûr, moi aussi, bon courage. |
| Marie : | Bye ! |
| MK : | Bye bye ! |
Je sors du bureau avec mes deux masques dans la main ; j’évite de les regarder. Plusieurs souvenirs de situations absurdes qui se sont produites depuis le début de la pandémie me traversent l’esprit en un instant. Je me demande sérieusement ce que cette pandémie va encore nous inventer. Ça ne fait pas deux jours que j’ai repris, je n’en peux déjà plus.
Le prochain article de cette série est disponible ici.
Marine Kneubühler, Université de Lausanne
[1] Les prénoms de toutes les personnes de mon entourage figurant dans mes autographies sont fictifs par souci d’anonymat.