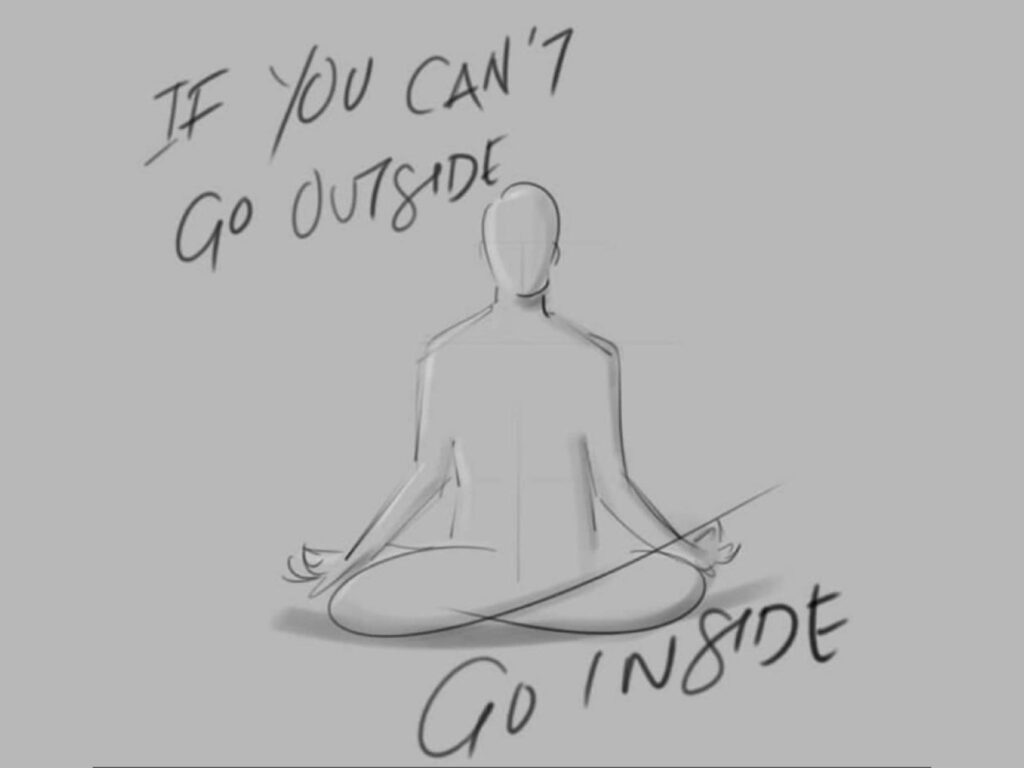Aman Dalal
« Si vous ne sortez pas de ce confinement avec de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances ou en ayant commencé à faire tout ce qui était en suspens, vous ne manquez pas de temps, mais de discipline. » Voici ce que (re)commande un professeur de yoga sur les réseaux sociaux.
Le devoir de solidarité, qui impliquait de rester chez soi, s’est accompagné d’une autre injonction, « devoir rester en forme », « garder une activité physique ». Le journal satirique le Gorafi relaie avec perspicacité et non sans ironie cette obligation, présente dans les médias : « ce n’est pas parce qu’on est confiné qu’il faut se laisser aller ». Cette injonction au bien-être n’est pas nouvelle, mais elle s’est renforcée avec l’obligation de rester chez soi.
Comment les pratiques physiques, de bien-être et de santé ont-elles été transformées entre mars et mai 2020 ? Ce texte vise à donner quelques éléments de réponse à partir d’une revue de presse non exhaustive en France et en Suisse. Plus d’une centaine d’articles de presse spécialisée sur le yoga, de journaux féminins ou de quotidiens ont été analysés et ressaisis à la lumière d’une trentaine d’entretiens semi-directifs menés auprès de pratiquants, de professeurs de yoga et de méditation.
Des pratiques hétérogènes
Du côté des pratiquants, cette enquête a souligné aussi bien des inégalités sociales que des changements dans les publics et dans les habitudes. Les techniques psychocorporelles, comme le yoga ou la méditation, sont des pratiques majoritairement féminines, avec une surreprésentation de catégories sociales moyennes et supérieures, et une moyenne d’âge autour de 40 ans[1]. Parmi ces pratiquant-e-s, beaucoup travaillent dans le social ou le médical. Dans le contexte de la pandémie, ces professionnels ont presque tous et toutes laissé de côté leur activité corporelle. Par ailleurs, les femmes âgées autour de 40 ans avec des enfants ont généralement eu une surcharge d’activité domestique et n’ont que rarement pu consacrer du temps à leur activité corporelle.
Le yoga et la méditation touchent un public souvent urbain, vivant parfois dans de petits espaces. Plusieurs pratiquants ont essayé d’aménager leur appartement, certains pratiquent dans leur couloir, la cuisine ou ont poussé des meubles. Ici, la profession, la situation familiale ou le lieu de vie ont fortement influencé la capacité à maintenir une activité physique. À l’inverse, les personnes sans enfant, vivant seules, avec une activité professionnelle en télétravail, voire au chômage partiel, ont largement augmenté la fréquence de leur pratique. Parmi les trente personnes interrogées, une dizaine n’ont pas pu maintenir leur activité physique en raison du travail, des enfants ou par manque de temps et d’espace. Les vingt autres ont intensifié leur pratique, passant parfois d’une pratique hebdomadaire à une pratique quotidienne. Un tel engouement de la part des enquêté-e-s s’explique par le contexte : plus de temps, des cours moins chers grâce aux applications, voire gratuits pour certains, et enfin des besoins spécifiques exacerbés par la situation : stress, angoisse, insomnie.
Pour les pratiquants passionnés, cette situation et cette reconfiguration de l’espace se juxtaposent à une volonté d’explorer un autre espace intime, celui de son intériorité, de son corps. Ces deux espaces, de la maison et du corps, apparaissent protégés, réconfortants, sécurisants. La situation du confinement permet alors au pratiquant de développer son « attention corporelle » (Nizard, 2019), c’est-à-dire une écoute du corps, des sensations, des émotions, de son vécu intime.
Transmettre par zoom ?

Du côté des professeurs, il a été indispensable de créer de nouvelles manières d’enseigner. Comment ces cours à distance ont-ils transformé les apprentissages ? La matérialité de l’ordinateur, du téléphone, de la tablette ainsi que les différents réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, YouTube ou encore des applications de cours en ligne comme Zoom, Vimeo, Loom ont connu une explosion. L’ampleur du phénomène est attesté par la croissance du nombre de vidéos sur Internet. À la date du 23 juillet 2014, Google recensait 3 540 000 vidéos et au 12 septembre 2018, environ 23 600 000 vidéos mettaient en scène une pratique où un professeur explique une posture ou donne un cours. Le 20 Mars 2020, il était possible d’en trouver 36 800 000 et 27 000 associant yoga et confinement, le 12 mai 2020, environ 39 700 000 et 190 700 dédiées à la pratique du yoga pendant le confinement. Ces quelques chiffres ne se veulent ni exhaustifs, ni représentatifs. Ils montrent cependant l’ampleur exponentiel du phénomène. Par ailleurs, il est impossible de recenser le nombre de cours donnés par des professeurs puisqu’ils utilisent des liens privés, diffusés par mail.
Le confinement et la distance sociale imposée ont modifié les modes et les méthodes d’apprentissage. Les professeurs, souvent indépendants, ont dû trouver des solutions, y compris techniques, pour survivre financièrement. Pourtant, nombre d’entre eux étaient jusque-là réticents à l’utilisation des technologies numériques. Leur pratique tend en effet à valoriser la relation unique et le contact direct d’un professeur avec ses élèves, conformément à la tradition ancienne, en Inde, du guru-sisya, c’est-à-dire de la relation directe, de la transmission orale entre un maître et son disciple. À l’oralité toujours présente s’ajoute un apprentissage par le corps, le contact, le toucher. Ces principes défendus dans le yoga expliquent pourquoi certains professeurs se refusaient à utiliser les réseaux sociaux.
Pourtant, confrontés à une réalité inédite, les professeurs comme les pratiquants ont dû se « réinventer » et adapter les modes d’apprentissage. « Il faut être beaucoup plus précis, proposer des variations dans les postures, pour chaque niveau. Je dois décrire mes gestes, mes sensations, mes émotions, alors que d’habitude je peux toucher la personne pour expliquer » (Joachim, 42 ans, professeur). Chaque professeur improvise à sa façon.
Certains continuent comme à l’accoutumée, se posent d’abord comme modèle, montrent les postures et guident par la voix. Ils laissent les pratiquants allumer ou éteindre leur caméra. Leurs élèves apprécient cette plus grande « liberté » dans le fait de respecter ou non les consignes, de se lever, parler, faire du bruit, chanter, mettre de la musique. D’autres professeurs bouleversent leur méthode. Par exemple, Rémi montre d’abord la posture, puis s’installe devant son écran pour donner des indications et corriger les postures de chaque élève. Ces professeurs souhaitent que la caméra reste allumée, orientée de manière à pouvoir voir les pratiquants dans toutes les postures. En cours, les professeurs ajustent physiquement, par le toucher, en aidant la personne à ressentir, en accompagnant le mouvement et en silence. Avec la caméra, le professeur donne des indications verbales compréhensibles et audibles par tous.
Contrairement au yoga, les professeurs et les pratiquants de la méditation n’ont pas vu leur modes d’apprentissage bouleversés, car ils sont habituellement guidés par la voix du professeur. Cependant, les réseaux sociaux ont bouleversé l’échelle de ces pratiques et réduit les distances géographiques, certaines méditations étant suivies par 2 500 personnes simultanément. Les transformations sont donc à géométrie variable. La pratique du yoga ou de la méditation s’adresse à un public privilégié et très spécifique. Pour un tel public, cette période est plutôt vécue comme une parenthèse salutaire et une occasion de s’impliquer dans une activité préexistante. De plus, le confinement a transformé les modes d’apprentissage du yoga. Reste à savoir de quelle manière ces pratiques évolueront dans les mois qui viennent.
Caroline Nizard, anthropologue, Université de Lausanne
[1] Hoyez A.-C. (2012), L’espace monde du yoga. De la santé aux paysages thérapeutiques mondialisés, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.
Nizard C. (2019), Du souffle au corps. Apprentissage du yoga en France, en Suisse et en Inde, Paris, L’Harmattan.