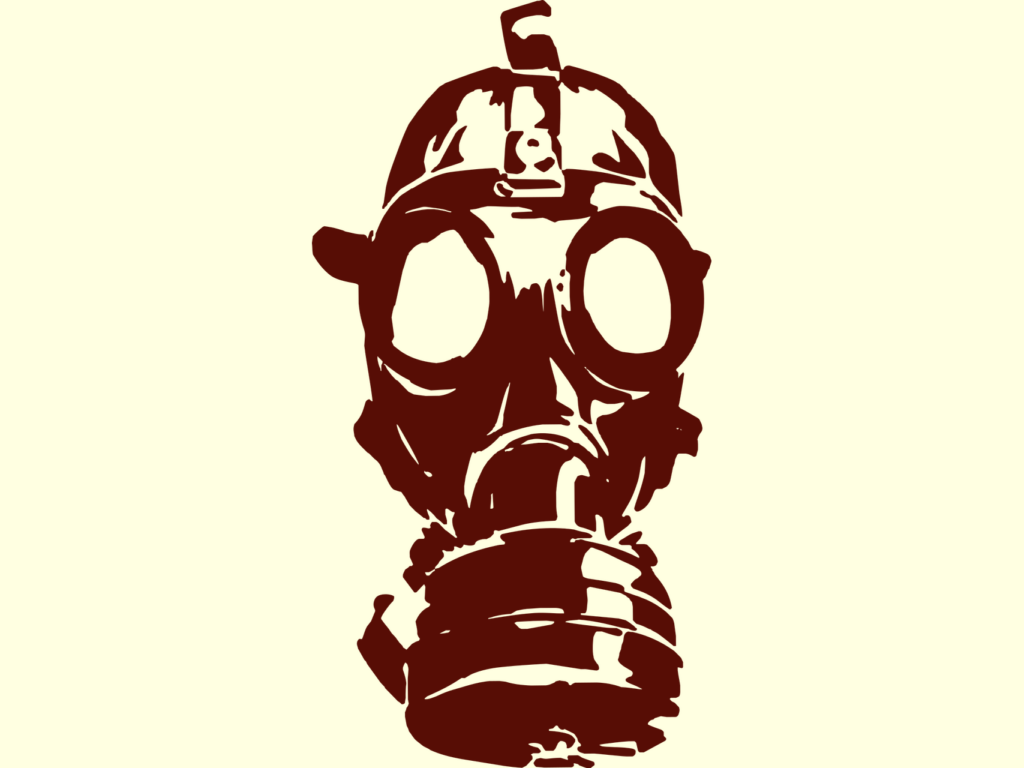Ça y est. Le bourdon de Notre-Dame a retenti, les rues sont vides, l’armée dresse des camps, le Charles De Gaulle a été touché par l’ennemi, les hôpitaux sont débordés par l’arrivée continue des blessés, on a sonné l’alarme, chacun se calfeutre. Le Président Macron l’a dit à plusieurs reprises lors de ses adresses télévisées à la Nation : c’est la guerre.
La France n’est pas la seule : Donald Trump a asséné : « It’s our big war ». Boris Johnson, le Sud Coréen Moon Jae-In, et bien d’autres chefs d’État ont également décrit dans ces termes la situation sanitaire. Pourtant, cette métaphore épargne relativement la Suisse, pays qui pourtant a mobilisé son armée dans d’importantes proportions et dont le chef d’État-major s’est exprimé plusieurs fois sur les chaînes de télévision.
Trois interrogations, donc.
La première concerne la facilité avec laquelle le terme de « guerre » est reçu. Il est vrai que nous ne ressentons pas immédiatement d’incongruité frappante, intuitivement, lorsque cette métaphore est utilisée pour la pandémie, alors qu’on pourrait s’attendre à ce que le public tique. Bien sûr, certains s’en émeuvent, mais du point de vue de l’intuition linguistique, il suffit de remarquer que si les chefs d’Etat avaient par exemple parlé de « conflit » plutôt que de « guerre », le message aurait suscité l’incompréhension. Or une guerre est par nature un conflit.
La deuxième concerne ce que l’usage de cette métaphore trahit au sujet de leurs auteurs. Certes on peut identifier assez facilement les bénéfices communicationnels escomptés, mais on peut alors se demander pourquoi ces bénéfices étaient eux-mêmes recherchés.
La troisième concerne la Suisse : pourquoi la métaphore de la guerre est-elle peu présente dans ce pays ? La réponse tient à plusieurs facteurs, que l’on peut penser identifier, mais une élaboration précise est sans doute à remettre à plus tard.
Concentrons-nous essentiellement donc sur les deux premières.
Dans les centres-villes, l’ambiance est plutôt morose ces derniers jours. Certes par beau temps des promeneurs plus ou moins masqués tournicotent par les rues ou les parcs encore ouverts mais veillent à ne pas croiser de trop près leurs congénères, tous suspects potentiels d’être des infiltrés, des chevaux de Troie de l’ennemi. Seuls bruits : non pas des bombes pourtant mais des ambulances qui passent à un rythme un peu trop soutenu. Guerre essentiellement silencieuse ; s’il s’agit d’une guerre, c’est la « drôle de guerre ».
Il y a de nombreuses sortes de métaphores et on peut les distribuer sur plusieurs échelles qui se croisent. Un de ces axes concerne leur caractère poétique ou non, qui provient de leur dimension plus ou moins déterminée. Ainsi, une métaphore au sens complexe, quelque simple qu’elle soit par ailleurs, comme le « Juliette est le soleil » que Shakespeare fait dire à Romeo, suscite des impressions plutôt que des contenus, et sont difficiles voire impossibles à expliciter par des propositions, des paraphrases. Que l’action de l’État contre un virus soit une « guerre » n’entre évidemment pas dans le domaine de la métaphore poétique, donc passons ce point. Un autre axe sur lequel il convient de positionner une métaphore concerne son caractère créatif, nouveau. Il y a des métaphores tout à fait originales (« Son encre est pâle », dit Flaubert au sujet du style de Leconte de Lisle), et d’autres si rebattues qu’elles se sont conventionnalisées, parfois à tel point que leur origine métaphorique a cessé d’être perçue depuis longtemps : elles se sont alors lexicalisées (« Je domine la situation » : la référence à l’espace, le fait d’être au-dessus, a cessé d’être accessible à la conscience des sujets parlants et donc l’impression métaphorique a disparu). Il y a entre ces deux extrêmes toutes sortes de cas intermédiaires. « Nous sommes en guerre », à propos d’une pandémie, est l’un de ces cas intermédiaires : nous accédons à la métaphore : nous savons par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une guerre. Cependant la métaphore guerrière est si présente dans nos représentations de tout ce qui suscite un stress collectif dont on peut identifier la cause qu’on peut dire sans crainte que cette métaphore est déjà conventionnelle : elle est relativement fréquente et familière. Ce sont précisément ces métaphores, qui ne sont pas lexicalisées et pourtant conventionnelles, qui marquent les esprits « épistémiquement » le plus efficacement. Elles ont cette importante propriété de produire des représentations simplifiées, familières, de problématiques complexes qu’il serait difficile de décrire autrement, et cette simplicité produit un sentiment de « faire sens », comme si elle permettait de résoudre un problème. Autant cela est un avantage courant dans la vie quotidienne, autant les distorsions qu’elles peuvent apporter sont parfois (très) dangereuses. Les métaphores créatives montrent trop ouvertement leur caractère métaphorique ; les métaphores poétiques sont trop vagues et sembleraient incongrues. Les métaphores conventionnelles sont parfaites pour remplir cet office de « résolution ». Elles sont courantes et donc leur acceptation est favorisée sans mobilisation significative de l’analyse critique, tout en apportant une satisfaction à l’esprit qui cherche la pertinence : en peu de mots, beaucoup d’effets.
Quels sont ces effets métaphoriques ? Il y a d’abord des effets émotionnels, qui proviennent des connotations évoquées par le mot ; pour la guerre, le stress, la peur, sont de la partie. Mais le plan des contenus est peut-être plus intéressant. Observons en effet ceci : les métaphores de ce genre suscitent des inférences – des conclusions – qui seraient également tirées s’il s’agissait du concept littéral. Ainsi, dans des circonstances de pandémie, la métaphore de la guerre fait conclure à des contenus tels que la nécessité du sacrifice, l’existence d’une entité dont il faut se protéger, et surtout l’union nationale et la suspension des débats démocratiques et parlementaires devant une urgence existentielle, exactement comme s’il s’agissait d’une guerre au sens propre. Bien sûr, la guerre, dans l’abstrait, évoque aussi bataillons, bombes, chars d’assaut et armées ennemies, mais comme le contexte – la pandémie – nous est présent à l’esprit, ce ne sont pas ces éléments, pourtant constitutifs de la guerre littérale, qui s’activent, mais seuls ceux qui semblent compatibles avec une histoire de virus et donc qui semblent pertinents.
C’est justement ce mécanisme qui rend à la fois la métaphore suspecte et efficace. Elle est suspecte, puisque conceptuellement, la guerre est un type de conflit (un conflit armé avec une autre forme d’institution, État ou groupe armé), or il est facile de s’apercevoir qu’on ne saurait dire – ou admettre – que nous sommes en conflit avec le Coronavirus. En revanche, le binôme « menace existentielle » et « union nationale » s’accorde bien avec nos représentations d’une dangereuse épidémie, inlassablement comparée aux grandes pestes. La métaphore est donc ressentie comme acceptable, puisqu’il existe une intersection valide entre certaines de ses implications littérales et celles que l’on peut tirer d’une menace sanitaire de grande ampleur.
La conséquence la plus avantageuse pour un gouvernement d’utiliser une telle métaphore est de faire cesser les débats et donc d’éviter au maximum la critique. Par conséquent, ce terme de « guerre » est, on peut en tout cas le penser, une marque de stress pour le gouvernement qui en fait usage.
Reste à se demander pourquoi le Conseil Fédéral et les autres autorités suisses n’y ont généralement pas recouru. Sur ce point, nous répondrons aussi vite que possible (cela tient probablement au système politique de milice qui lui-même est la marque d’une culture politique différente, où la relation entre les gouvernants et la population est relativement confiante) mais aussi lentement que nécessaire (cela demande réflexion).
Louis de Saussure, Chaire de linguistique et analyse du discours, Université de Neuchâtel